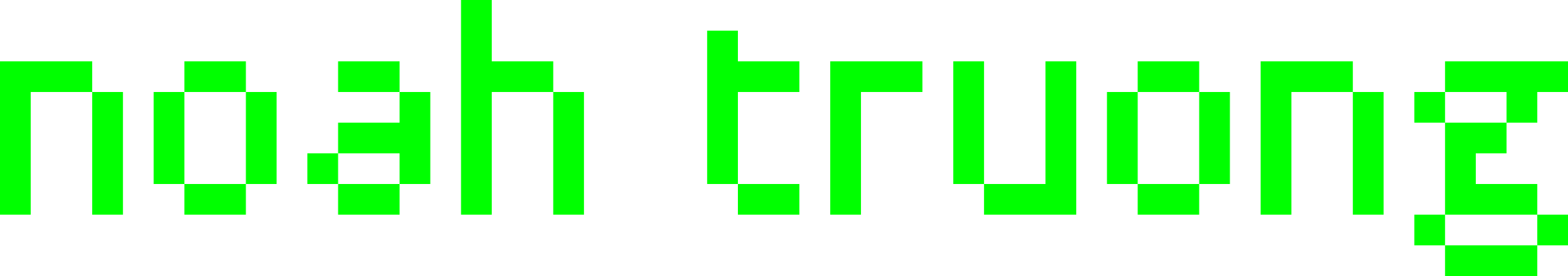MON PÈRE DE GUERRE (EXTRAITS)
En consultant, depuis Paris, le site internet sur lequel mon père répertorie et expose une partie de ses toiles, je remarque une chose qui ne m’avait pas particulièrement frappé auparavant.
Il faut dire que je me suis gardé de regarder de trop près ses images, ou trop longtemps. Pourtant, je les ai toujours côtoyées. Les images de mon père font partie des décors de ma vie, plus qu’elles ne les ont ornés.
Le tableau d’une scène d’un marché de rue d’Hanoï, au milieu duquel avance une grosse locomotive noire, chassant les passants avec leur cargaison, le temps que le train passe. Sur une terre auburn, sienne, presque menaçante, comme éclairée par un brasier.
Un marché de bord de rivière, des femmes amenant les marchandises sur des barques avant de repartir de l’autre côté de la rive. La jungle du Vietnam, verte, vivante, qui teinte les tissus de son humidité et qui grignote presque la moitié de la toile.
Des voiles de jonques crénelées, semblant serties de griffes comme les ailes d’un rapace préhistorique, posées sur des eaux roses, lilas, bleus, pêche, contrastant sur des ciels blancs ou or, et à d’autres endroits bleus azur.
Des portraits, des scènes de rue, des paysages dans lesquels la rizière est noire, et les plants de riz trempent dans une eau rougie par le soleil couchant.
Je les décris, là, de mémoire, sans jamais les avoir regardées attentivement. Mais cela me frappe d’un coup en les voyant toutes ensemble, et je cherche parmi la galerie de la page web la toile qui viendra infirmer mon hypothèse.
Il n’y a pas de Blancs dans les images du Vietnam de mon père.
Il n’y a pas de colon. Pas un seul.
On peut voir, sur une des toiles, une devanture de magasin où sont écrits en français les mots « bazar » et « marchandises », juste à côté d’une enseigne rédigée en caractère chinois, qui indique que la scène doit se situer à Saigon, dans le quartier de Cholon.
Les boutiques témoignent du passage des colons dans la ville – pendant 100 ans, rappelons-le. Mais on ne découvre nulle autre présence française, nul maître qui veille.
Comme si le corps colonial s’était déjà volatilisé, ne laissant que des vestiges, mais que la vie vietnamienne a déjà retraduit dans sa propre langue. La langue du présent, celle du recouvrement du passé par l’action et sa poussière.
Paradoxalement, cela signifie aussi que sa propre mère est absente de ces peintures.
On y voit parfois des femmes caucasiennes, mais dans des décors qui sont nettement situés en Europe. Elles sont habillées, debout devant un café. Elles posent à un coin de rue, dans un port.
Mais il n’y a pas de femme française, et encore moins de mère, dans le Vietnam de mon père.
Peut-être ces deux idées ne peuvent-elles pas cohabiter ensemble.
La mère française, et le Vietnam.
Peut-être n’a-t-il pas su où les faire se rencontrer, dans l’espace du Vietnam, même sur la toile.
Mais que faire, alors, de l’idée, et de la représentation de lui-même, le résultat de cette rencontre ?
Que penser de l’irreprésentable ?
*
Lorsque sa femme a fait un AVC, il y a cinq ans, mon père a déménagé à Saint-Malo, dans la maison où ses grands-parents bretons avaient vécu, puis son père et sa mère, jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus y rester seuls.
Je suis allé trier des livres dans la cave de son atelier, à Paris, pour récupérer ceux qui m’intéressaient avant qu’il ne doive vider les lieux.
C’est comme ça que je suis tombé sur un album dessiné, dans le style de la ligne claire, représentant sur sa couverture une jeune fille d’Asie de l’Est, en sous-vêtements, le corps parfaitement proportionné selon les standards pornographiques. Elle était semblable en tous points aux représentations des femmes dans les bande-dessinées d’espionnage sur l’« Orient » qui ont pullulé dans les années 80 : grande, mince, les pommettes rondes, les lèvres rouges et petites, sauf que sa jambe droite était amputée au-dessus du genou, le moignon encore enrubanné.
J’ai ouvert le livre pour le feuilleter. Ce n’étaient que des dessins de femmes, toutes d’Asie de l’Est, représentées dans des positions sexuellement suggestives et amputées là d’un bras, là d’une jambe, là des deux, ou parfois seulement le visage contusionné, les poignets pris dans des menottes, ou harnachées à une table chirurgicale.
Le nom du dessinateur sonnait français.
Juste en dessous de chaque dessin, il y avait une légende, qui variait à chaque fois :
« Akito, la petite-fille du général Hei, le premier général de l’armée des forces impériales japonaises. ».
« Mariko, la nièce du directeur du contre-espionnage du district d’Osaka »
Le livre datait de 1986. Et sur la première page, on lisait en écriture manuscrite :
« Cher Marcelino,
Amicalement… »
J’ai appelé immédiatement mon père à Saint-Malo, depuis la cave, à Paris.
« Ah oui, je vois très bien qui c’est. », il m’a dit. « Il était très à la mode dans les années 80. C’étaient les années Métal Hurlant, la BD se voyait comme une contre-culture très punk, très à gauche. Il était dans le groupe des types branchés, des anar et des libertaires. Je ne l’aimais pas du tout. Il dessine à partir de photos. Il a fait un shooting avec une femme avec qui j’avais une relation. Je l’ai appelé, je lui ai dit que si je le croisais, je lui casserais la gueule. »
Il ajoute :
« Sa femme est japonaise, d’ailleurs. »
J’ai répondu à mon père, seul dans son atelier, à Paris :
« Si je croise ce type dans la rue, je l’emmène dans une cave, et je lui tire une balle dans la tête. »
Mon père a eu sa mesure habituelle. Sa voix de baryton calme, qui participe à la kermesse de l’école catholique de son quartier depuis des années.
« Oui, oui, je comprends… Moi non plus, je n’aimais pas beaucoup ses dessins. Je trouvais ça de très mauvais goût. Mais ça ne soulevait aucune sorte d’indignation, à l’époque. C’était post mai 68, tu sais, on disait qu’il fallait briser tous les tabous. »
J’ai raccroché.
Où est la rage de mon père ?
Où est son couteau ?
Ce jour-là, j’ai déchiré les pages du livre. Avec mes mains. Je l’ai détruit.
D’abord, j’ai eu un peu honte, comme si j’étais de ces gens qui détruisent les livres. Plus tard, j’ai regretté, parce que je n’étais plus en sa possession. J’aurais aimé l’avoir conservé, archivé dans un placard avec d’autres preuves, comme les policiers patients avec les affaires classées.
A ce moment, je n’ai pas su pas quoi en faire d’autre. Le garder chez moi ? Je n’aurais pas supporté de savoir qu’elles étaient là, mutilées, démembrées, détruites dans les pages du livre.
Je me demande ce qu’il est devenu aujourd’hui, ce dessinateur, avec sa femme japonaise et ses peut-être enfants français et japonais. Est-ce qu’il a une fille ? Comme je l’ai été ? Une fille métisse pas amputée, ou alors d’une seule jambe, côté japonais ?
*
Je ne suis pas allé au cimetière de Saint-Malo depuis l’enterrement de mon grand-père Buu Khanh. Il y a quatorze ans maintenant. Je vais à Saint-Malo mais pas au cimetière. Jamais. Je l’évite. Il est juste derrière la maison de mon père, qui était celle de mes grands-parents, et des parents de ma grand-mère avant eux. Il me faudrait, quoi, cinq minutes, pour y arriver ? Il est exactement à la même distance que la mer. De la mer, à la maison de mon père, au cimetière : un triangle parfait.
Je passe devant quand je viens à pied de la gare, mais je n’y vais pas. Je l’ignore. Il est derrière un muret et une rangée de platanes toujours dégarnis. Je l’ignore.
Je pourrais y aller mais je n’y vais pas. Comme je n’écoute pas mon père, ou comme j’ai appris à ne pas l’écouter quand je descends l’escalier à mon réveil et qu’il est déjà à sa table de travail, dans l’entrée, qu’il lève les yeux vers moi, sourit, cligne des yeux, et dit quelque chose comme :
- Tiens ! Tu as bien dormi ? Je suis en train de regarder un documentaire formidable sur Napoléon sur Youtube. Juste avant qu’il soit emprisonné sur Sainte-Hélène, il avait rendu visite à sa seconde épouse (…)
Je secoue la tête. Je déconnecte.
Mon père n’a pas le sens du moment. Il n’a pas le sens de l’autre. S’il voit quelqu’un et si ce quelqu’un a des oreilles, il lui parlera de ce qui l’intéresse. Le film qu’il a regardé, un livre qu’il a lu, un détail historique. On croirait qu’il existe sous une autre atmosphère.
En dessous de sa tête, il y a son corps, de mari présent, d’aidant affairé. Ce corps, dans son atmosphère terrestre, accomplit une centaine d’actions dans l’espace de la maison, comme un robot nourricier. Il donne les soins du matin à sa femme handicapée, cuisine, passe au marché, à la pharmacie, se rend à la poste, répond à des messages en dictant à son téléphone, « Majuscule. Je suis allé ce matin, virgule, mais c'était fermé. Point ». Il redresse le lit de sa femme, allume la télé pour elle, lance le dîner pour plus tard, puis se rassied à sa table de travail. Il a cent bras et un tablier à motif de fraises et de cœurs. Il a un fichu sur la tête et des sandales de ménagère.
Mon père me pose des questions comme : « Tu manges bien ? » « Tu vois tes amis, quand même ? » et me donne des conseils comme : « C’est important de bien manger. Ne te surmène pas trop. » Exactement les mêmes que ma Grand-mère maternelle qui ne se souvient plus de mon prénom, et qui meuble. Il se tient un peu penaud devant moi, les traits hésitants. Je sais que c’est le mieux qu’il puisse faire. Qu’il n’y arrive pas. Il n’est pas équipé pour l’intimité, pour l’échange.
« Mon père était comme ça. J’ai toujours une sorte de timidité. J’ai eu une éducation vietnamienne », il plaide quand je le lui reproche.
Sa tête est ailleurs. Il porte un casque invisible rempli d’images. Ses yeux sont plongés dans la couleur et les sons. Sa bouche et ses narines, tous les conduits de sa tête, baignés de liquide onirique. Mon père rêve. Il s’exprime en faits historiques. Il réfléchit en frise chronologique.
Je m’assieds dans la cuisine, pour boire mon café, alors que je suis arrivé la veille au soir et que je ne l’ai pas vu depuis six, huit mois, et il entre pour me dire immédiatement : « Je suis en train de lire une biographie très intéressante d’Elie de Saint-Marc. Il a servi en Indochine dans les années 1870. C’était un grand général. »
Je ne sais pas quoi répondre, alors, je ne réponds pas. Ce n’est pas qu’il m’ennuie, ou que je le désapprouve. C’est simplement que j’ai l’habitude de côtoyer la tête de mon père. Je vis avec elle depuis ma naissance. Elle est comme une jeune vie à l’enveloppe faite uniquement d’excitation, et qui ne peut s’empêcher de vouloir la partager avec la première personne que mon père croise, même si ce n’est pas le moment, et même si cette personne voudrait parler d’autre chose, comme de la vie. Celle que nous essayons, que j’essaye de vivre. Et il est là, dedans. Mon père.
J’ai appris à l’accepter et à l’aimer, cette tête de mon père. Cet homme tendre, généreux, fier, vulnérable, opiniâtre au travail, très doux, et en même temps inaccessible. Absent. Troué dans tout le corps, avec de l’air qui passe dedans. Il est là mais on ne peut pas lui parler. Il est là mais il ne l’est pas. Il est assis à sa table. Silhouette penchée, un coude à angle droit, et l’autre le long du corps, saisie entre deux lampes comme pour un interrogatoire. Il a ses lunettes. Il ne lève pas la tête si je passe. Ce sont simplement ses pupilles qui bougent, et sautent au-dessus des verres. Il travaille. Il ne faut pas le déranger. Il est assis comme ça depuis ma naissance. Depuis le premier réveil de ma vie, jusqu’au moment où je vais me coucher, il est encore à la même table. Il travaille.
*
Enfant, je regarde mon père dessiner. Parfois pendant des heures. Son atelier est dans l’appartement. J’y cours dès que je rentre de l’école. C’est la première chose que je fais.
Je m’installe à son bureau où il y a partout des petits tubes de gouache à moitié roulés, tachés, débouchés. Des palettes sèches qui s’empilent. Des verres maculés de peinture eux-aussi, pleins d’une eau lilas, carmin, bleu laiteux. Mon père est penché à sa table lumineuse. Il dessine, ou bien il met en couleur. Son pinceau fin va chercher l’encre de Chine dans le pot noir, au ventre de barrique. Les poils souples suivent le trait de sa main, lui offrent leur souplesse, leur existence rieuse. C’est la vie du trait qui compte dans le dessin, et pas ce qu’il figure et qui apparaît lentement. C’est un geste qui passe sa joie, sa dureté, son élan à la feuille et qui l’en macule. La main s’éloigne, la force demeure. Elle prend sa vie propre. Elle s’émancipe, s’étale, exulte. La ligne rit de tout son ventre noir de brigand. Il faut se reculer pour la sentir. Se reculer dans la vie, prendre un pas en arrière, s’éloigner de ses yeux et de son visage, s’extraire de la peau de sa poitrine pour regarder d’un peu plus loin. Il faut cesser d’être humain, un temps, pour devenir ligne. Devenir mouvement et vie sur le papier. Qu’on regarde, ou qu’on dessine, il faut laisser la ligne, le mouvement prendre empire sur soi. Accepter d’être remplacé par elle. Son rire courbe à l’intérieur de soi. S’éteindre jusqu’à ce que la ligne ait achevé sa danse, qu’elle se soit entièrement vidée sur le papier.
C’est une transe dont en sort abandonné. Nous avons été visités, et l’encre a coulé des yeux par les veines du poignet, jusqu’au pouce et à l’index, dans une frénésie de dépense. C’est un geste de foi. Une prière d’un mouvement contenu et minuscule. Comme rendre un hommage à la plus petite des fourmis de l’Océanie.
Mon père dessine, et je regarde prendre le dessin. Je le suis dans ses images, dans sa ligne. Je suis très calme. Je ne le dérange pas. J’ai juste besoin du contact de son bras sous le mien, de sa jambe près de ma hanche, et de sa ligne sur ma rétine. C’est comme ça que je rentre dans ses images. Dans son rêve. Comme ça que je parcours avec lui ses paysages. Je laisse, moi aussi, des litres de couleur entrer par mes yeux, mes narines, ma bouche. M’emplir tout entier. Père et enfant pleins de couleur, voguant sur une mer de peintre.
Pour sortir de la couleur l’arrachement. Il faut se jeter en arrière. Tirer sur les couleurs de ses yeux jusqu’à ce qu’elles lâchent prise en geignant, un bruit de déchirure. Il faut retourner à Paris, dans l’appartement. Reprendre son visage normal. Vérifier qu’on a pas de la couleur partout, qu’on a bien ses deux yeux, qu’ils ne sont pas restés là-bas. Se détacher du bras de son père, écouter sa voix basse et chaleureuse, qui dit quelque chose de gentil. Revenir là. Aller dans la cuisine, retrouver sa grand-mère. S’allonger sur le sol pour jouer.
On restera avec les images. Un peu de couleur reste toujours, derrière les yeux, il parait. C’est une maladie. Un spectre qui s’étend, se multiplie discrètement. On continue sa vie. On ne se doute de rien. On est plein de couleur mais on l’ignore. On en est de plus en plus plein et on ne le sait pas. C’est comme ça qu’on est pris par le rêve. Que le rêve prend le dessus. Peut-être. Lorsque les couleurs entrent en crue et que leur vague recouvre nos yeux, notre tête. Que nous sommes pris dans une mer de couleur, un océan de lumière qui chatoie. Nous respirons dedans. Du parme. Du lilas. Du jaune de naples. Du sienne. De l’ocre. Du bleu roi. De l’or. De l’émeraude. Du vert forêt. De l’écarlate.
C’est une noyade.